Le sous-titre, « J’étais carmélite et un prêtre m’a violée », veut résumer l’essentiel du témoignage –d’une façon tapageuse. Or La Tyrannie du silence pose en réalité toutes les questions de l’engagement religieux, questions si complexes que la jeune femme, comme tout croyant fervent et sincère, cherche à les élucider, soit par le « discernement spirituel » d’un prêtre, soit par l’interprétation signifiante de « signes ». Si les circonstances s’y prêtent, ces interrogations essentielles, leur gravité d’être, peuvent devenir un redoutable accès au plus intime de l’âme.
Un alléchant magazine vante une « Ecole de Vie, une école d’évangélisation en France (…) Toute la richesse de l’Eglise s’étale devant mon esprit émerveillé » se souvient Claire : offices splendides, fraternité avec des jeunes non-francophones venus du monde entier, enseignements variés, trois missions par an… « Je partirai en France. Je vais passer une année à EV. J’entrerai au Carmel sous le vocable du Sacré-Cœur » comprend-elle. Un mois d’observation au Carmel précèdera la formation à l’Ecole de Vie.
Quelques courtes années après sa conversion, Claire rejoint la France, la tête bourrée d’idées de saints sacrifices, le cœur rempli de joie, et l’esprit, d’idéal. L’austérité de l’ordre déchaussé ne lui fait pas peur : en Ukraine, on ne mange pas à sa faim ! Pas d’argent, un visa temporaire : la Providence veillera à tout. La joyeuse communauté d’EV abonde dans la certitude bienheureuse que Dieu la conduit.
La postulante met finalement les pieds dans un Carmel, un peu isolé, du sud de la France : « Entrer en clôture directement, sans avoir vu la communauté ni fait le stage, était providentiel aussi. Manifestement. Car mon courage naturel et mon ardeur d’origine surnaturelle sont partis comme une fusée vers le ciel – et ne sont plus jamais revenus- dès le moment où l’odeur de renfermé, à l’ouverture de la porte, m’a enveloppée de son étreinte collante. » Ce Carmel est une sorte d’Ehpad monastique en manque de personnels comme de subventions.
Le drame commence : drame d’un quotidien insupportable, drame intérieur d’un sens qui est peut-être faux : « J’aurais pu dire non. J’aurais pu. Mais une telle fuite aurait été le gaspillage des grâces qui m’ont été données gratuitement (…) Comment refuser ce sacrifice à Celui que j’aimais ? » s’interroge Claire. Comment répondre à cette question ? Aucun des experts théologiques et autres « pères spirituels » rencontrés ne s’y risquera, trop pleutres, ou trop indifférents, pour assumer un regard sur une carmélite qui a prononcé ses vœux perpétuels. C’est le premier choc de La Tyrannie du silence : pas un pour prendre le risque fraternel du vertige.
La novice, devenue en six mois sœur Virginie de la Résurrection, est happée dans cette spirale, d’autant plus infernale qu’elle s’arc-boute à des « signes » garants de la volonté divine dans ce quotidien insupportable, comme à la quête désespérée d’un « frère spirituel ». Les mises en exergue de citations de saints du Carmel semblent surplomber le chapitre comme autant d’impossibles injonctions mystiques : mais comment les contester ? « Oui, la souffrance m’a tendu les bras et je m’y suis jetée avec amour » dit sainte Thérèse de Lisieux. Alors…
Dans cet univers confiné de femmes vieillissantes et acariâtres, attachées à leurs « offices » comme autant de manies, cette jeunesse passe mal mais reste pratique : Claire, pour survivre à ce qui ne cesse plus de la détruire intérieurement, s’acharne à repeindre, poncer, sarcler, nettoyer, vider. Elle retape le monastère. Fait la cuisine aussi. Elle s’épuise. Un monde de folie, de méchanceté, d’exploitation, de bêtise. On commence à s’agacer des grandes idées sacrificielles de Virginie, on a envie de foncer, de la virer de là, de l’aider à trouver un boulot et un logement. On rêve des choses normales qui ne se sont jamais produites. Bien plus tard, elle sera autorisée à quitter la clôture, mais sans ressources et sans logement, aidée de rares amis.
Seule une retraite prêchée par un prêtre a le pouvoir de distraire les esprits de leurs aliénations, pour mieux les y enchainer, à grands coups de sublime, tout drapé des prestiges mystiques. Arrive celui qui, pour sœur Virginie de la Résurrection, signera « Pierre-Judas », singulier mais limpide oxymore tandis qu’elle chute toujours, dans ces sortes de tunnels noirs qu’on voit dans des cauchemars et dans des fièvres. Ce n’est pas le début de la fin, c’est la suite. Le prêcheur fait l’unanimité. Laid comme un pou, mais bon comme le pain. Le « frère spirituel », finalement c’est lui.
A partir de ce moment du récit, il convient vraiment de distinguer les étapes d’approche du stratège « Pierre-Judas ». La première phase, relativement longue – l’auteur reste imprécise sur les dates- est dédiée à l’écoute et au réconfort de l’âme blessée. La sœur désemparée se livre, peu à peu, exprime ses doutes profonds sur sa vocation, pleure et, ce faisant, en réalité, se défait. La seconde est rapide, sûre. Le fruit mûr, blet, tombe, s’écrase. Non, ce n’est pas encore le viol, c’est une tentative de baiser à la grille du parloir. C’est de là que tout part.
Un presque rien. Pour quelqu’un qui va bien là où il est, pour qui le sens de la vie est à peu près lisible, qui n’est pas trop à plat et qui s’en tape de la soutane, ça vaut juste une baffe et un « casse-toi, pauvre con ».
Pas pour Claire, qui aussitôt sombre dans de labyrinthiques scrupules, se terre en elle-même pour ensuite chercher, éperdue, une parole qui la guide, qui la pose, qui la relève. Arrive une brochette d’abrutis redoutables, dignes « pères spirituels » fournis par occasion. On est dans un film, presque. On se pince, on lâche des « mais c’est dingue » assis dans son fauteuil. On n’en peut plus.
Arrive le temps du viol, pendant dix-huit mois. Claire-Virginie vit hors-clôture une inexistence qui a un corps, c’est tout. C’est ce qu’elle appelle la dissociation, une organisation particulière de la psyché pour éviter la folie complète ou le suicide. Au choix.
La Tyrannie du silence s’ouvre par la rencontre, tant attendue, tant espérée après les faits, avec le Provincial, mélange d’Ubu Roi et de Nosferatu – mais le grotesque et l’épouvante ne s’opposent pas forcément. Donc dès le début, on sait. On sait que sœur Virginie de la Résurrection a zéro chance d’être entendue, respectée, soutenue. C’est le coup de grâce.
Claire Maximova dépose plainte.
On est heureux de lire que les pauvres pêcheurs de ce monde si égaré sont les seuls à lui avoir porté secours ; parmi eux, un prêtre qui l’a écoutée vraiment, encouragée à faire valoir son droit.
Bravo, Claire.
Anne Thoraval
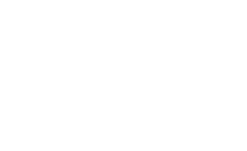
 La Tyrannie du silence
La Tyrannie du silence