Nous publions ici la partie centrale du discours. L’intégralité du discours est disponible sur le site du Vatican.
- La maladie de se croire « immortel », « immunisé » voire même « indispensable », au point de négliger les contrôles nécessaires et habituels. Une Curie qui ne s’auto-critique pas, qui ne se met pas à jour, qui ne cherche pas à s’améliorer… est un corps malade. Il suffit d’aller dans un cimetière pour voir les noms de tant de personnes, dont certaines se croyaient certainement immortelles, immunisées et indispensables ! C’est la maladie de l’homme riche et insensé de l’Évangile qui pensait vivre éternellement (cf. Lc 12, 13-21) et aussi de ceux qui deviennent des petits chefs, qui se sentent supérieurs au reste du monde, au lieu de se mettre au service des autres. Cette maladie provient généralement d’une pathologie du pouvoir, du « complexe des élus », du narcissisme de celui qui regarde sa propre image avec passion et ne sait plus voir l’image de Dieu imprimée sur le visage des autres, en particulier des plus faibles et des plus nécessiteux. L’antidote à cette épidémie est la grâce de se savoir pécheurs et de dire avec tout son cœur : « Nous sommes des serviteurs inutiles : nous n’avons fait que notre devoir » (Lc 17, 10).
- La maladie du « marthalisme » (qui vient de Marthe) qui consiste en une activité excessive : c’est-à-dire de ceux qui se noient dans le travail et qui négligent inévitablement « la meilleure part » : s’asseoir aux pieds de Jésus (cf. Lc 10, 38-42). C’est la raison pour laquelle Jésus a demandé à ses disciples de « se reposer un peu » (cf. Mc 6, 31), parce que négliger le repos nécessaire conduit au stress et à l’agitation. Le temps du repos, pour celui qui a accompli sa mission, est une nécessité, un devoir, et doit être vécu sérieusement : il s’agit de passer un peu de temps avec ses proches et de respecter les jours de vacances comme autant d’occasions pour se ressourcer spirituellement et physiquement. Il faut se souvenir de ce que le Qohéleth nous enseigne : « Il y a un temps pour tout » (Ec 3, 1-15).
- Il y a aussi la maladie de la « pétrification » mentale et spirituelle : c’est-à-dire la maladie de ceux ont un cœur de pierre et une « nuque raide » (Ac 7, 51-60). Ce sont ceux qui perdent petit à petit la sérénité intérieure, la vivacité et l’audace, et finissent par se cacher derrière la paperasse. Ces gens ne sont plus « des hommes de Dieu », mais des « machines » (cf. Heb 3, 12). Qu’il est dangereux de perdre la sensibilité humaine qui nous permet de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent ! C’est la maladie de ceux qui ont perdu « les sentiments de Jésus » (cf. Ph 2, 5-11) parce que leurs cœurs, au fil du temps, se sont endurcis et qu’ils sont devenus incapables d’aimer le Père et leur prochain sans condition (cf. Mt 22, 34-40). Être chrétien, cela signifie en effet « avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5), des sentiments d’humilité et de don de soi, de détachement et de générosité.
- La maladie de la planification excessive et du fonctionnarisme. Quand l’apôtre planifie tout minutieusement et s’imagine qu’en faisant une parfaite planification, les choses avancent réellement, il devient un comptable ou un simple commercial. Il est nécessaire de bien faire son travail, mais sans tomber dans la tentation de vouloir enfermer ou contrôler la liberté de l’Esprit Saint, laquelle demeure toujours plus grande, plus généreuse que toute les planifications humaines (cf. Jn 3, 8). On attrape cette maladie parce qu’il « est toujours plus facile et plus commode de s’installer dans ses propres positions statiques et inchangées. En réalité, l’Église est fidèle à l’Esprit Saint dans la mesure où elle n’a pas la prétention de le diriger ni de le domestiquer… – domestiquer l’Esprit Saint ! – Lui qui n’est que fraîcheur, fantaisie, nouveauté ! »
- La maladie de la mauvaise coordination. Cela arrive quand les membres du corps perdent la communion entre eux, et que le corps, privé de son fonctionnement harmonieux et de sa tempérance, devient un orchestre qui ne produit que du bruit, parce que ses membres ne collaborent plus ensemble et ne vivent pas dans un esprit de communion et d’équipe. C’est comme si le pied disait au bras : « je n’ai pas besoin de toi » ou que la main disait à la tête : « c’est moi qui commande », causant ainsi embarras et scandales.
- Il y a aussi la maladie d’« Alzheimer spirituel » : autrement dit le fait d’oublier « l’histoire du salut », d’oublier son histoire personnelle avec le Seigneur, d’oublier « le premier amour » (Ap 2, 4). Il s’agit d’un déclin progressif des facultés spirituelles qui, à plus ou moins long terme, peut provoquer de graves handicaps chez la personne, la rendant incapable d’exercer une activité autonome et vivant recroquevillée sur ses opinions, la plupart du temps imaginaires. Nous voyons une telle chose chez ceux qui ont perdu la mémoire de leur rencontre avec le Seigneur ; chez ceux qui ne perçoivent pas le sens deutéronomique de la vie ; chez ceux qui sont totalement dépendants de leur présent, de leurs passions, caprices et manies ; chez ceux qui construisent autour d’eux des murs et des habitudes et deviennent de plus en plus esclaves des idoles qu’ils ont sculptées de leurs propres mains.
- La maladie de la rivalité et de la vanité. Cette maladie arrive quand l’apparence, les couleurs des vêtements et les signes honorifiques deviennent le premier objectif de la vie, oubliant les paroles de saint Paul : « Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres » (Ph 2, 3-4). C’est la maladie qui nous conduit à être des hommes et des femmes faux et à vivre un faux « mysticisme », un faux « quiétisme ». Saint Paul définit ces gens comme des « ennemis de la croix du Christ » parce qu’ils « se vantent de ce dont ils devraient avoir honte et ne pensent qu’aux choses de la terre » (Ph 3, 18-19).
- La maladie de la schizophrénie existentielle. C’est la maladie de ceux qui mènent une double vie, fruit de l’hypocrisie typique du médiocre et du vide spirituel progressif qu’aucun diplôme ou titre académique ne peut combler. Une maladie qui frappe souvent ceux qui, abandonnant le service pastoral, se limitent aux tâches bureaucratiques et perdent ainsi le contact avec la réalité, avec les personnes concrètes. Ils se créent ainsi un monde parallèle, où ils mettent de côté tout ce qu’ils enseignent sévèrement aux autres et où ils commencent à vivre une vie cachée et souvent dissolue. La conversion est urgente et indispensable pour lutter contre cette grave maladie (cf. Lc 15, 11-32).
- La maladie des rumeurs, des médisances et des commérages. J’ai déjà parlé à de nombreuses reprises de cette maladie, mais peut-être pas encore assez. C’est une maladie grave, qui commence de façon anodine, peut-être juste pour faire un brin de causette, et qui s’empare de la personne, portant celle-ci à devenir un « semeur de zizanie » (comme Satan), et dans beaucoup de cas à « tuer de sang froid » la réputation de ses propres collègues et confrères. C’est la maladie des personnes lâches qui, n’ayant pas le courage de parler en face des gens, parlent dans leur dos. Saint Paul nous met en garde : « Agissez en tout sans murmurer et sans hésiter afin d’être irréprochables et purs » (Ph 2, 14-18). Frères, gardons-nous du terrorisme des bavardages !
- La maladie de ceux qui divinisent les chefs. C’est la maladie de ceux qui courtisent leurs supérieurs, en espérant gagner ainsi leur bienveillance. Ce sont des victimes du carriérisme et de l’opportunisme, qui préfèrent honorer les personnes plutôt que Dieu (cf. Mt 23, 8-12). Ces personnes effectuent leur service en pensant uniquement à ce qu’ils peuvent obtenir, et non à ce qu’ils doivent donner. Ce sont des personnes mesquines, malheureuses et inspirées seulement par leur petit égoïsme fatal (cf. Ga 5, 16-25). Cette maladie peut également toucher les supérieurs lorsque ces derniers courtisent certains de leurs collaborateurs pour obtenir leur soumission, leur loyauté et leur dépendance psychologique, mais il en résulte au final une véritable complicité.
- La maladie de l’indifférence à l’égard des autres. Cette maladie arrive quand chacun ne pense qu’à soi et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Quand le plus expert ne met pas sa connaissance au service des collègues moins experts. Quand on apprend quelque chose et qu’au lieu de le partager avec les autres, on le garde pour soi. Quand, par jalousie ou par esprit retors, on éprouve de la joie à voir l’autre tomber au lieu de le relever et de l’encourager.
- La maladie du visage d’enterrement. C’est la maladie des personnes grincheuses et sinistres, qui s’imaginent que pour être sérieuses il faut arborer un visage de mélancolie, de sévérité, et traiter les autres – surtout ceux que l’on considère comme inférieurs – avec rigidité, dureté et arrogance. En réalité, la sévérité théâtrale et le pessimisme stérile sont souvent des symptômes de peur et de d’insécurité. L’apôtre doit s’efforcer d’être une personne courtoise, sereine, enthousiaste et joyeuse qui transmet la joie là où il se trouve. Un cœur empli de Dieu est un cœur heureux qui irradie et communique sa joie à tous ceux qui l’entourent : cela se voit tout de suite ! Ne perdons donc pas cet esprit joyeux, plein d’humour, et même d’autodérision, qui font de nous des personnes aimables même dans les situations difficiles. Quel bien nous fait une bonne dose d’humour sain ! En ce sens, réciter souvent la prière de saint Thomas More peut nous faire le plus grand bien : je la récite tous les jours, et cela me fait du bien.
- La maladie de l’accumulation. Cette maladie arrive lorsque l’apôtre cherche à combler un vide existentiel dans son cœur en accumulant des biens matériels, non par nécessité, mais seulement pour se sentir en sécurité. En réalité, nous ne pourrons rien emporter avec nous car « le linceul n’a pas de poches » et tous nos trésors terrestres – même les cadeaux – ne pourront jamais combler ce vide. Au contraire, cela ne fera qu’attiser ce manque, que rendre le trou encore plus profond. À ces personnes, le Seigneur rappelle : « Tu dis : ‘Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien’, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ![…]. Sois donc fervent et convertis-toi » (Ap 3, 17-19). L’accumulation ne fait que nous alourdir et ralentir inexorablement notre chemin ! Je pense à une anecdote : Autrefois, les jésuites espagnols décrivaient la Compagnie de Jésus comme étant la « cavalerie légère de l’Église ». Je me souviens de ce jeune jésuite qui déménageait : alors qu’il était en train de charger dans un camion tout ce qu’il avait – bagages, livres, objets, cadeaux –, un vieux jésuite qui l’observait lui a dit : « Alors c’est ça la ‘cavalerie légère de l’Église’ ? » C’est lors de nos déménagements qu’apparaissent les signes de cette maladie.
- La maladie des cercles fermés. Cette maladie arrive quand l’appartenance à un petit groupe devient plus forte que celle due au Corps et, dans certaines situations, au Christ lui-même. Cette maladie commence aussi par de bonnes intentions, mais au fil du temps, elle asservit ses membres, devient un cancer qui menace l’harmonie du Corps et cause beaucoup de mal – de scandales –, spécialement à nos frères les plus petits. L’autodestruction ou les « tirs ami » de ses compagnons est le danger le plus insidieux. C’est un mal qui frappe de l’intérieur ; et, comme dit le Christ, « tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine » (Lc 11, 17).
- Enfin la dernière : la maladie du profit mondain, du besoin de se mettre en avant. Cette maladie arrive quand l’apôtre transforme son service en pouvoir, et son pouvoir en marchandise pour obtenir des profits mondains, ou davantage de pouvoirs. C’est la maladie des personnes qui cherchent insatiablement à multiplier les pouvoirs et à cette fin, ils sont capables de calomnier, de diffamer, de discréditer les autres, jusque dans les journaux et les magazines. Tout cela, bien sûr, dans le seul but de se mettre en avant et de montrer qu’ils sont plus doués que les autres. Cette maladie fait elle aussi beaucoup de mal au Corps parce qu’elle conduit les personnes à justifier l’usage de n’importe quel moyen pour atteindre leur but, souvent au nom de la justice et de la transparence ! Il me vient à l’esprit le souvenir d’un prêtre qui appelait les journalistes pour leur raconter – et inventer – des choses privées et indiscrètes sur ses confrères et sur ses paroissiens. Pour lui, seul comptait le fait de se voir à la une des journaux, parce qu’ainsi il se sentait « puissant et impérieux », causant beaucoup de mal aux autres et à l’Église. Pauvre homme !
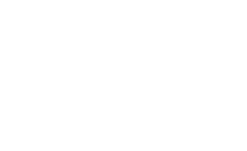
 François et les 15 maladies spirituelles qui affectent l’Eglise
François et les 15 maladies spirituelles qui affectent l’Eglise