1) Selon nos sources, la distinction entre secte et dérive sectaire n’a pas tant été instaurée pour éviter l’amalgame avec la religion, que pour mettre en avant la diversité des phénomènes sectaires. La plupart des études montrent en effet que chaque cas présente son propre degré de gravité et ses propres caractéristiques.
Ainsi, l’idée selon laquelle il n’y aurait pas de « secte » dans l’Église mais seulement des « dérives sectaires » ne nous semble pas pertinente : on considère généralement qu’il y a « secte » lorsqu’un certain nombre de critères sont réunis. Or, dans certaines communautés controversées, toutes les caractéristiques sont réunies pour qu’on ne parle pas de simples « dérives sectaires », mais bien de « sectes ».
En revanche, il convient de souligner l’ambiguïté du mot « secte » qui recouvre deux significations différentes, et à certains égards contradictoires. C’est notamment à cause de cette équivocité que de nombreux malentendus ont produit des controverses douloureuses, ces dernières années, avec des conséquences très dommageables pour les études sur le sectarisme, pour l’appréhension de cette réalité par les responsables politiques, religieuses et judiciaires, et en dernière instance pour les victimes. [1]
Pour faire bref : selon l’acception traditionnelle, le terme de secte désigne une branche dissidente d’une religion dominante alors que selon l’acception moderne – issue de la psychologie – les sectes désignent des communautés dysfonctionnelles dirigées par une (ou des) personne(s) perverse(s) et dont les membres sont progressivement réduits à un état de servitude psychologique par le truchement de discours mensongers et de différents techniques de manipulations mentales. Une congrégation religieuse peut être affiliée à l’Église catholique, respecter scrupuleusement la pureté de la doctrine, mais, dans la pratique, utiliser des techniques de recrutement et de gestion humaine gravement immorales.
L’idée selon laquelle « dans l’Église catholique, il n’y a pas de secte » est le reliquat d’un préjugé qui a précisément induit les autorités de l’Église en erreur pendant des décennies : c’est en effet parce qu’elles présumaient trop souvent que l’institution ecclésiale était comme « immunisée grâce à l’action de l’Esprit-Saint » que certains pasteurs de l’Église ont cru qu’il était inutile ou vain d’exercer un quelconque devoir de discernement et de vigilance, si bien que certaines dérives ont pu se développer au sein de l’Église… et produire les terribles dégâts que nous découvrons aujourd’hui avec stupeur.
2) L’article décrit bien les opérations à mettre en place en cas de dérives. Cependant, dans la pratique, les choses sont hélas trop souvent différentes. Notre expérience nous montre que les dirigeants de communautés controversées ont l’habitude de chercher la protection d’évêques complaisants et de « cultiver » des liens d’amitiés avec la hiérarchie. La justice est rarement impartiale. Dans la plupart des cas – les plus graves – que nous traitons, un faisceau de preuves indique qu’à chaque fois, « les dés sont pipés » : comme si les enquêteurs n’allaient pas tant pour chercher la vérité que pour étouffer le scandale et protéger l’œuvre. En général, les victimes n’obtiennent ni justice ni réparation, et n’ont que leurs yeux pour pleurer.
Le collectif de lenversdudecor.org
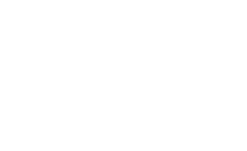
 Journal La Croix : Comprendre les dérives sectaires
Journal La Croix : Comprendre les dérives sectaires